Ca va pas bien tu vois j’ai des milliers de petites aiguilles dans le cerveau qui me piquent et se tordent dans la chair, j’ai beau tirer dessus elles ne ressortent jamais, elles me brûlent et elles s’agitent quand je marche, salopes d’aiguilles tordues, je ne me sens plus marcher, je ne me sens plus respirer, alors je me force, je me tape dans la main pour les réveiller, j’ai peur de m’endormir, j’ai peur de ne plus rien sentir, j’ai peur ds fourmis dans les pieds et de mon oeil qui voit la lumière en plein soleil, j’ai peur d’avoir peur, j’ai peur de mourir, je voudrais planter un couteau dans mon bras pour voir si je suis toujours là, parce que si je saigne c’est que mon coeur bat encore, je voudrais voir le sang couler au rythme de mes pulsations, à grosses gouttes rythmées par le bam bam sur le parquet sale, c’est ca être maniaque, c’est ne plus savoir si tu es là ou pas, si tes pieds sont posés ou si tu flottes dans un état de rage terrible comme si tu pouvais plus jamais te calmer, comme si il fallait frapper quelqu’un ou te pendre pour que ca s’arrête, cette boule d’énergie qui te pousse à faire de la merde, mes doigts frappent trop fort sur le clavier, peut-être que mes doigts sont morts et que je ne pourrais plus jamais écrire, peut-être que la nuit ne cessera pas, j’ai mal derrière la paupière à force d’avoir cette voix qui hurle dans mon cerveau, j’en peux plus de l’entendre, je sais plus comment la faire taire je voudrais que ca s’arrête, je voudrais taper, je voudrais frapper, mettre mon poing dans la gueule de quelqu’un.
Je voudrais être belle je voudrais être bonne je voudrais plaire à tout le monde je voudrais qu’on m’aime pour toute la vie je voudrais qu’on se retourne quand je passe et qu’on ne m’oublie jamais, je voudrais pas qu’on m’abandonne, je voudrais pas être seule chez moi, mais quand tu supportes personne, quand t’as envie de mordre, quand tu voudrais taper tes genoux dans le béton, arracher tes ongles avec tes dents pour essayer de te sortir de ce coma surexposé, tu vois personne et tu t’enfermes, parce que tu contrôles rien, parce que t’es là à regarder ce film que t’arrive pas à suivre, tu sais pas comment ca va finir, c’est pas un putain de Disney, ca a pas de sens, rien n’a de sens, ni la musique ni les images, rien ne te rappelle la maison, ca sent bizarre, ca ressent bizarre, y’a rien qui marche putain, tu sais pas si t’as froid ou si t’as chaud, tu t’habilles comme une pute et tu te crois belle, tu sors et sur le palier tu réalises ta méprises, t’es juste saucissonnée dans tes habits du dimanche, tu vas nulle part, t’es personne et personne ne t’attend, y’a pas de bal dans l’ascenseur, personne pour te faire danser, pose ta poubelle Cosette, retourne te changer, tu pars bosser, envie de vomir, toujours cette putain d’envie de frapper, le premier la première, peut-être toi, t’as la phobie de t’y mettre, de te planter dans l’open space et de t’ouvrir les veines, tu sais pas pourquoi, t’en as même pas envie mais tu penses qu’à ca, tu sais pas pourquoi je te dis, et plus t’y penses moins tu comprends, la phobie d’impulsion, on t’a expliqué déja, essaie de te détendre, détends toi, tout va bien, la lumière du néon, l’ordinateur du travail, le casque sur les oreilles, tous ces gens à qui il faut parler, t’es qui, t’es qui toi, et je vais te casser la tête, envie de raccrocher, envie de me barrer, reste calme putain respire toujours ce putain de néon qui veut pas, qui ne veut pas griller.
Alors quand elle s’amène, la connasse avec son évaluation et ses conseils à la con, ca part tout seul, j’arrive pas à retenir, je lui tombe dessus, je sens que ca monte, elle va payer, je m’énerve, elle a le temps de rien dire, je sais même pas ce qu’elle allait dire putain, je la déchire, elle veut pas parler, elle veut plus me parler, je suis ingérable, c’est pas ma faute, c’est le néon et le bruit dans ma tête que j’arrive pas à arrêter, alors je suis obligée de parler plus fort, je suis obligée de gueuler, sinon personne n’entend sinon personne m’écoute, je gueule putain, je m’entends gueuler, je suis folle pour de bon, je dis de la merde, tout ca n’a aucun sens, ferme ta gueule putain ferme là, mais je peux pas, faut que je pense à mes machoires, à les fermes, à rentrer ma langue, faut que je ferme ma gueule mécaniquement, avec toute la volonté des mes os et de mes muscles pour réussir à endiguer la boue qui dégueule de ma gorge, je le fais mais je vois bien que j’ai niqué la nana, elle se casse les yeux mouillés, je m’en fous je veux la frapper, mais non parce que je m’en veux, alors j’ai à moitié envie de pleurer, et puis j’ai peur parce que je vais me faire virer, mon collègue se marre et moi je ne sais pas quoi faire, est ce que je me lève, est ce que dehors c’est mieux avec l’air sans la lumière, et puis mon chef, viens me voir, tu peux pas parler comme ca, comment je lui explique qu’est ce qu’on peut dire, c’est sorti tout seul, c’est la boue, je te jure, j’ai pas fait exprès alors je resserre les dents du plus fort que je peux, je me concentre sur mes molaires, faut qu’elles se touchent, faut pas qu’elles se décollent, hoche la tête et ferme ta gueule, tu retournes à ta place et tu te tais, parce que ce que je veux c’est exploser mon poing sur la partition en formica de ce bureau de merde, je veux faire un tas de merdes en bois et tout faire crâmer, je veux que ca pue l’essence et qu’on danse autour, je veux plein de bruits, je veux dormir mais je n’y arrive pas, 4 jours déja, pas dormir, les fourmis dans la tête, faut que ca s’arrête. Je rêve d’un grand incendie. Je rêve de me foutre le feu à l’intérieur, que ca brûle bleu. Craquer une allumette, danser sur les cendres, ca sent la viande morte, le cadavre, la chair dégouline et la graisse suinte brillante, tombe en grosses gouttes molles à mes pieds. Les morts sont raides, froids, engoncés dans des boîtes, climatisés à jamais, je voudrais brûler, je voudrais vivre, quitte à disparaître, quitte à hurler. J’ai vu le cadavre de cette femme qui venait de sauter de sa fenêtre, encore trop bien coiffée sur le trottoir mouillé, comme si la chute avait suspendu le temps, sa chemise encore consciencieusement rentrée dans son pantalon pincé, il y a encore une minute elle se penchait simplement au dessus du vide, pour calculer sa mort, pour anticiper le bruit de ses os sur le bitume glissant, elle a rentré sa chemise dans son vêtement, pour s’assurer qu’elle resterait digne, les cheveux attachés sur son crâne fracassé. Elle était là, entière, comme intacte, son sang seul continuait à vivre sans elle, elle se répandait là, devant sa porte d’immeuble, la tête d’abord, et puis une marée sombre sous son dos brisé. Je me suis demandée si elle avait débranché le téléphone, si elle avait pensé à écrire ses dernières volontés, ou si elle avait sauté, prise à la gorge par son grand incendie, calcinée de l’intérieur avec rien pour l’apaiser.
Je connais les incendies, ceux que mon cerveau déclenche parfois, quand les molécules s’emmêlent stupides autour de mes synapses trouées, comme des centaines de bougies d’anniversaires magiques, celles qu’on achète pour faire enrager le petit dernier, tu perds ton souffle, tu postillones sur la crème pâtissière, elle ne s’éteint jamais. Imagine une chambre noire, son ampoule rouge et son ambiance ouatée, et soudain des milliers de clignotants, des stroboscopes, sans prévenir l’incendie reprend, explose tes pellicules, tout est gris sur le papier révélé, plus rien ne s’imprime à la surface, tout est contenu dans les éclairs qui s’acharnent à te dévorer la cornée, tes yeux ne fixent plus la couleur, alors tu te regardes l’intérieur, tu te concentres pour éteindre les flammes, mais rien ne fonctionne jamais. Alors comme les fous, tu te mets à parler trop fort, à fermer les yeux et à taper dans les murs, parce que rien ne contient le feu, rien n’arrête la destruction enclenchée, tu cherches le sommeil, tu dors le jour parce que la lumière se superpose à ta douleur et que tu la confonds presque avec du bien être, l’obscurité force le contraste, la nuit l’incendie est plus fort que jamais.
Je voudrais brûler d’un incendie franc, me consumer et disparaître. Une fois réduite à rien, une fois poussière, sang séché sur viscère molle, il n’y aura plus rien à contenir, rien à réprimer. Une sorte de retraite bouddhiste fulgurante, ascétisme garanti, retrouvez votre concentration et votre ligne grâce à nos dix méthodes faciles vers l’ataraxie. Crac, une allumette, bien sur c’est douloureux, on ne quitte pas facilement des années d’ego et de stimulis inutiles, ne plus rien ne ressentir c’est compliqué, mais avec de la bonne volonté, vous allez y arriver.
J’essaie, tu vois. Je me soigne. Mais tu reviens. Putain de fantôme. Connard de cerveau. Je ferme la porte. Je n’écoute pas cette chanson. Je change de chaîne. Je tourne en rond. J’allume fort la lumière, même la nuit, je brûle de l’encens, des bougies. Je ne regarde pas derrière l’armoire, il n’y a rien sous mon lit. Je chante fort dans les parkings, dans les tunnels, je remplis mes oreilles de cris. J’essaie, mais je n’y arrive pas. Tu me rattrapes, tu me cherches, tu ne me laisses pas. Tu es là. Une ombre, un détail, une lettre qui tombe de la bibliothèque, d’autres ouvrent la Bible pour deviner le hasard, je n’ai qu’à te laisser la place de venir pour que tu te manifestes. Barre toi putain. Dégage. J’y crois même pas, à ces conneries, aux esprits. Je conchie les voyantes et les tireuses de cartes, je crois aux morts qui reviendront pourtant, c’est un élégant paradoxe. Mais pas maintenant. Pas comme ca. Tu reviendras gonflé de chair dans ton corps d’adulescent, le sourire narquois, la clope au bec, tu reviendras en te marrant, certainement pas en te planquant dans un courant d’air.
Si c’est toi, c’est pas drôle vraiment. Tu vois bien que ca me rend triste. Tu vois bien que je n’ai pas oublié. Pas la peine de me torturer. Je respecte nos rituels. Je t’attends devant notre café. Je me plante là, l’enseigne a changé tu sais, plus de cascade de bulles cheap à l’entrée. Tu détesterais. J’allume une cigarette, je guette le bout de ta rue, pour quelques minutes je me persuade que tu es seulement en retard. 15 ans de retard, qu’est ce que ca fait, je peux bien t’attendre encore, le temps de te revoir, en transparence, comme une décalcomanie que je rajoute à un décor en papier mâché. Je t’assois, sage, à la table près de la fenêtre. Tu es là, ou presque. A chaque fois, la même larme débile, celle de l’oeil droit, la larme unique, radine, j’ai trop pleuré déjà, c’est la fumée dans mes yeux, c’est le film qui repasse en boucle, celui de la dernière fois, ta voix que je reconstitue maladroitement, pour la conserver, pour ne pas l’oublier. Tu es mort, je peux bien te manipuler, en choisissant de te retirer, tu m’as donné le droit de tout réécrire, de tout refaire cent fois quand le sommeil arrive, d’imaginer des retours mièvres, des envolées fantastiques. Tu n’as plus rien à dire. Tu ne diras plus jamais. Rien.
Je fais du bruit contre ton esprit, pour qu’il s’éloigne de moi, je fais du bruit dans ma tête pour tuer les souvenirs de toi, rien n’y fait, je te porte entre deux côtes, là où c’est tendre, là où c’est chaud, là où ca coince, où ca tord, je te porte comme un mal de coeur, comme une exigence, je te porte et je ne peux pas t’abandonner. Je ne suis pas la seule, je sais bien, à souffler dans l’urne pour que tes cendres ne retombent jamais, je n’avais pas le monopole, quand tu vivais, maintenant que tu es mort, je suis libre de m’imaginer que tu n’aimais que moi, je suis libre de dégommer les autres, pan l’autre brune, pan le boulot, il n’y a plus que nous. C’est moi qui décide, quand tu viens et quand tu pars, je n’ai plus à céder à ton emploi du temps, je ne concède plus rien. Je te convoque au gré de mon envie, tout le reste, je bloque. Tu râles je vois bien. Tu fais tomber les livres, tu fais claquer les portes. Tu es mort, mon vieux, il faut que tu t’y fasses. Ecoute, c’est le hip hop des gouttes de pluie, clac, claquent les dents jaunies du vieil homme décati, c’est juin et puis juillet à Paris. Pourtant je vais bien, il me semble du moins, l’angoisse bien au ventre, mais contrôlée, nuage de lait dans mon tea time anglais, les jardins de ronces perdent de leur superbe quand on refuse de s’y piquer, j’ai donc résolument raisonnablement peur de tout mais beaucoup moins de moi. La thérapie par la parole, veuillez vomir ici à heure fixe chaque semaine s’il vous plaît, les médicaments sans doute, et puis surtout la vie, putain de sa race, l’envie, les cheveux roses, le soleil qui se planque, la force qui bouscule tout, incompressible. J’ai toujours eu tres envie de vivre, c’est idiot de le dire, j’ai toujours voulu tout goûter, tout voir, tout comprendre et tout lire, plus vite, sans m’arrêter, de peur que le temps file, de peur de devoir m’en aller, et quand mon cerveau pourri me laissait croire le contraire, quand les yeux étaient clos même en pleine lumière, j’avais la vie aux tripes, sanguinolente, pulsative, violente, des remontées de sève comme d’acide. J’honore comme une déesse, comme un vieux Bouddha usé, cette vie qui reprend en moi les terres abandonnées, Attila conquérant de mes frousses les plus profondes, elle se bat quand je renonce, elle repousse sur les chairs brûlées. Je suis l’ultime greffon, la dernière repique, la nouvelle pousse, et si ce n’est plus le printemps, ça pourrait y ressembler.
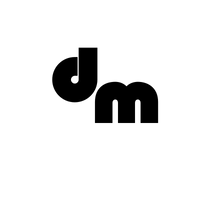
Laisser un commentaire